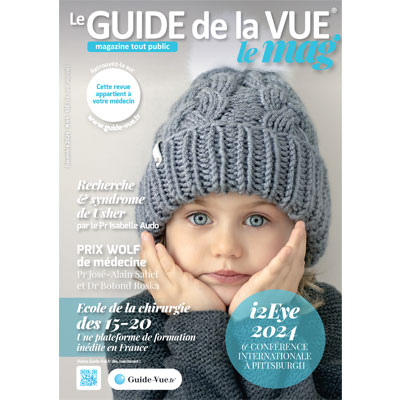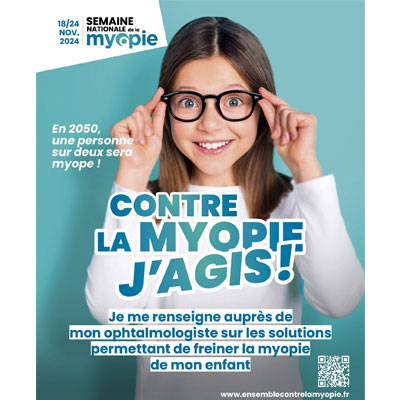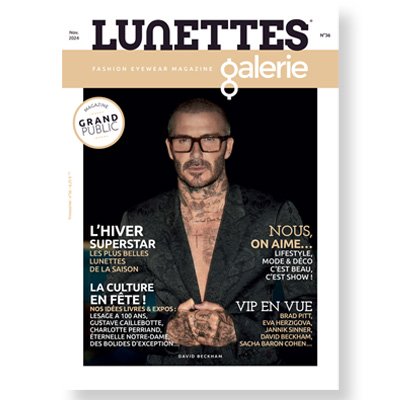09/12/2024
Dans cette 2e partie, nous abordons les différentes approches pour traiter le strabisme, qu’elles soient médicales ou chirurgicales. En plus de corriger la vision, ces traitements visent souvent à atténuer les impacts psychosociaux liés à ce trouble, notamment à travers la chirurgie, solution de référence dans de nombreux cas.